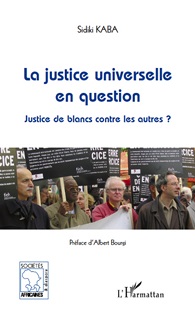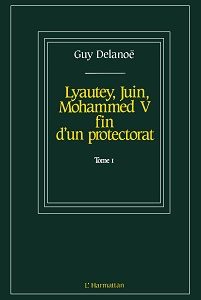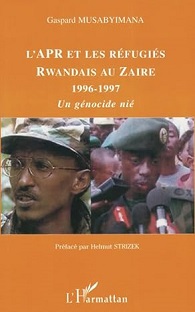Sidiki Kaba
La Justice universelle en question – Justice de blancs contre les autres ?
L’intérêt de cet ouvrage est de mettre en perspective certaines ambiguïtés de la justice pénale internationale, les ressorts politiques qui les sous-tendent et le caractère encore inachevé de l’édifice en cours. En évoquant les cas de Charles Taylor, de Saddam Hussein, de Pinochet et de Hissène Habré, Sidiki Kaba relate les calculs politiques qui ont entouré leurs procès, ou l’absence de procès. On saisit la trame politique des procédures inachevées ou expéditives et des délocalisations sans raison, sinon politique, des procès.
.
Vous aimerez aussi
Lyautey, Juin, Mohammed V fin d’un protectorat
Ces « Mémoires historiques » concernant le Protectorat français du Maroc sont rédigés par un Français qui vécut les 45 premières années de sa vie au Maroc, et ne perdit jamais le contact avec sa terre natale. Longtemps convaincu de la bienfaisance du Protectorat (ses parents, tous deux médecins, consacraient leur vie à la population marocaine), il connut son chemin de Damas lorsqu’il fut nommé médecin du travail d’une grande entreprise industrielle. En découvrant la classe ouvrière marocaine et sa misère, il comprit le sens qu’avait le mot « Protectorat ». C’était au moment du premier affrontement Juin-Mohammed V (février 1951) : Phase essentielle d’un complot ourdi de longue date, derrière lequel on percevait la silhouette de Georges Bidault… Le 20 août 1953, le Sultan Mohammed V fut déporté à Madagascar. La France se privait, en cette période de décolonisation, du seul interlocuteur possible. Mais après avoir fait signer par le « successeur » une loi qui faisait des Français les seuls maîtres du Maroc, les hommes du « complot » (Auriol) crurent avoir partie gagnée. Ils n’avaient pas prévu l’insurrection spontanée et immédiate du peuple marocain, qui devint bientôt une guerre maghrébine. Ils n’avaient pas prévu non plus Dien-Bien-Phu (mai 54). La France fut amenée à se déjuger. Le Roi Mohammed V regagna son pays le 16 novembre 1955. Au cours de cette dernière phase, 75 Français avaient publié, pour sauver l’honneur de la France, une lettre adressée au Président de la République, qui faisait référence aux « valeurs que la France n’a cessé d’incarner aux yeux du monde » et demandait un changement de politique à Rabat. L’auteur fut l’un des signataires de cette lettre. Pour rédiger ce long travail (le livre comprend deux tomes) l’auteur a bénéficié de ses propres souvenirs, souvent consignés sur le vif, de l’accès aux Archives du Quai d’Orsay, de celles de l’Armée, au Château de Vincennes, de celles du Roi Mohammed V à Rabat, et de nombreux mémoires et témoignages de première main, d’amis marocains et français, qui lui ont permis de rendre vie à ce passé trop vite oublié.
Les marrons glacés
Natif de Saint-Louis au Sénégal, Samba Ndiaye a longtemps roulé sa bosse comme professeur de français et chevalier du micro en Algérie et dans sa patrie. Dans le cadre de l’écriture, il est détenteur du Grand Prix de poésie de la Maison africaine de la poésie internationale
En habile collectionneur de mots, l’auteur ressuscite superbement les mythes de l’enfance, de l’amour, de la beauté et du rêve… « Les marrons glacés » est un recueil peignant un univers pittoresque qui semble nous montrer les choses et les Hommes sous un autre jour.
Le dernier des nomades
C'est dans un Eden perdu que le jeune Oul Alou a fait ses premiers pas. Ses parents et toute la communauté nomadisent entre Boutilimitt, Tantan et Tindouf pour revenir à l'atmosphère du fleuve Sénégal. Ce roman mauritanien nous fait connaître la vie des Maures et leur volonté de ne pas disparaître. El-Ghassem Ould Ahmedou est né en 1952 à Rkiz en Mauritanie. Il est titulaire d'un doctorat en lettres modernes française, d'un doctorat en ethnologie et d'un troisième doctorat en sciences de l'éducation. Il a publié plusieurs ouvrages sur le désert mauritaniens et ses habitants nomades.
En 1996-97 tous les camps des réfugiés hutu rwandais, situés au Sud et au Nord-Kivu, furent bombardés puis démantelés par l’armée tutsi. Les rescapés furent traqués dans les fôrets inhabitées de la RDC pour y être achevés, le nombre de disparus s’élevant à 200 000. Le Haut Commissariat pour les réfugiés ainsi qu’une partie de la « communauté internationale » ont une grande part de responsabilité dans ces assassinats de masse vraisemblablement ordonnés par Kigali. Qualifiés ou non de Génocide, les massacres des réfugiés rwandais au Zaïre constituent un crime contre l’humanité.